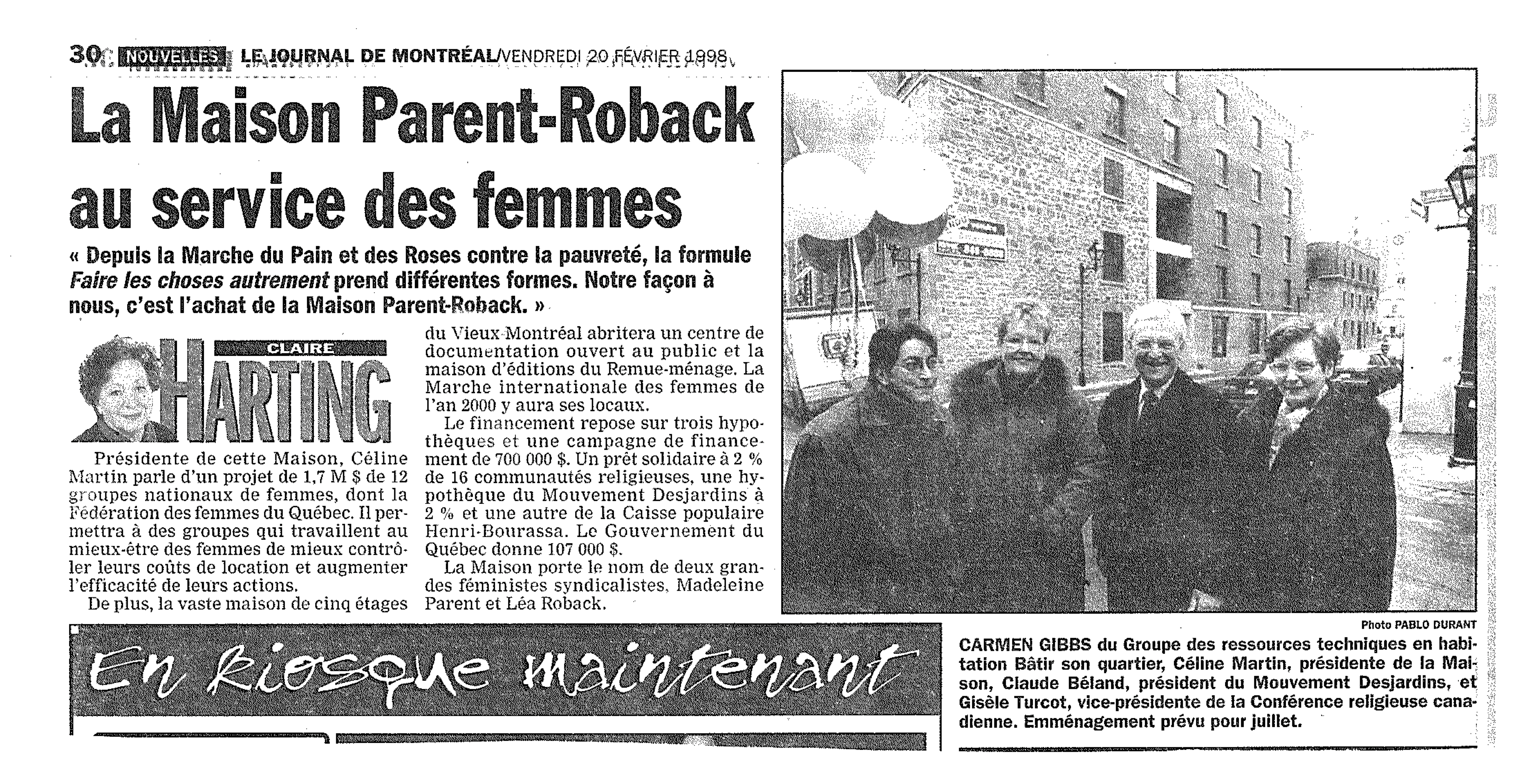Un peu de contexte
Au Québec, au début des années 1980, la crise des finances publiques aux niveaux provincial et fédéral engendre des coupures dans les services publics. Les organismes communautaires prennent conscience du désengagement de l’État. Cette crise économique a un impact direct sur les groupes féministes au Québec et leur financement¹.
Le projet de rassembler différents organismes féministes dans un même lieu a germé dans l’esprit de groupes féministes dès le début des années 1980. Manifestant cette volonté de concevoir un organisme à vocation de collecte de fonds au Québec, l’idée d’acheter un édifice public est lancée par des pionnières de ces groupes².
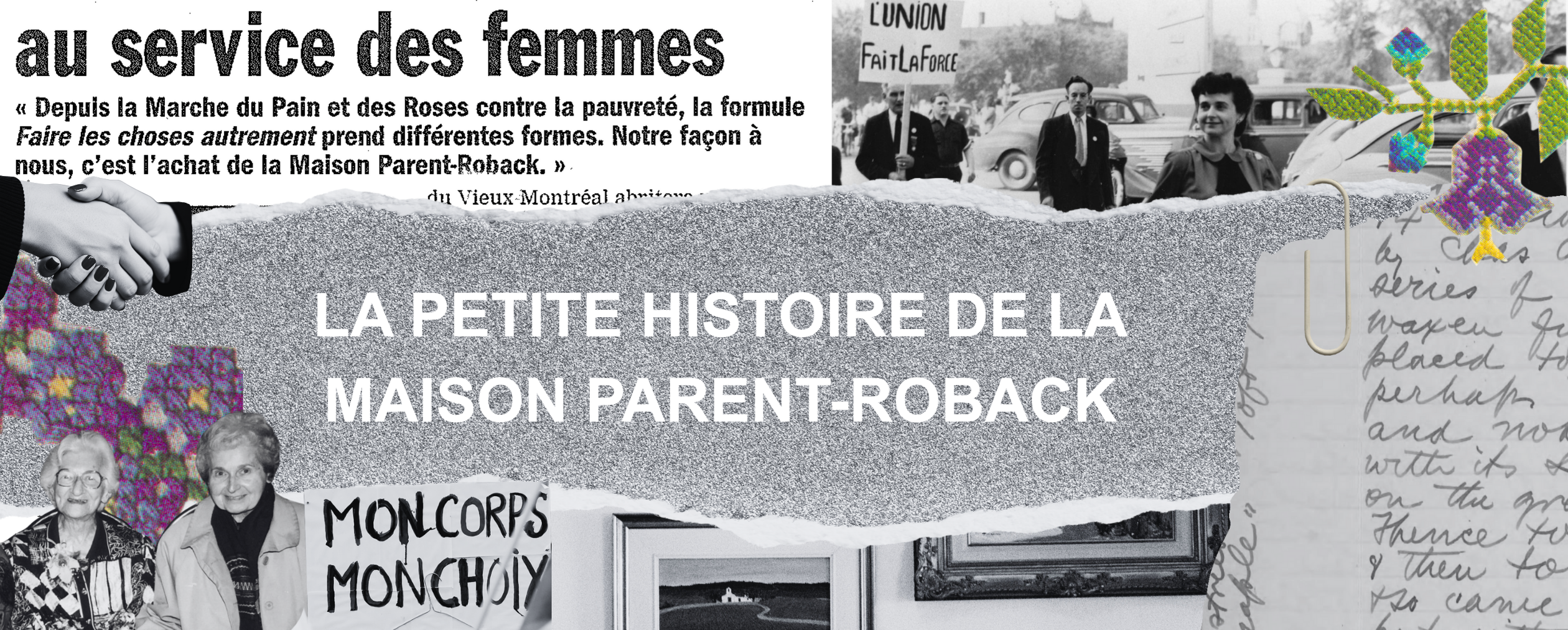
Un projet innovant collectif et féministe
1985 : En réponse à la diminution de leur financement, les groupes féministes québécois se rallient afin d’accroître leur efficacité et leur force. 1985 marque la continuité de cette coalition entre groupes féministes; le partenariat étant devenu nécessaire pour faire face aux coupures budgétaires³.
1986 : On fait part du projet « de la Maison », soit d’acheter un édifice collectif au Groupe des Treize, groupe fondé en 1986. Le Groupe des Treize a pour but d’augmenter l’efficacité de la réponse féministe aux enjeux sociaux et politiques⁴.

Léa Roback et Charlotte Thibault en 1997
1988 : L’élection du Parti Conservateur au Canada en 1988 a pour effet de diminuer le financement des groupes féministes, notamment dans la décennie qui suit. Cette élection engendre la diffusion d’un discours antiféministe, notamment émis par le Parti réformiste, qui appelle à la fin du financement des groupes féministes⁵.
1989 : Au Québec, la « Loi modifiant le Code civil du Québec et d’autres dispositions législatives afin de favoriser l’égalité économique des époux » (22 juin 1989) entraine la montée du masculinisme et la formation de groupes antiféministes⁶. Cet élan antiféministe s’illustre par la médiatisation de l’« Affaire Chantale Daigle » (juillet-août 1989) et par la tragédie de la Polytechnique.
1990 : Dès le début des années 1990, le Canada entre dans une période de récession économique. Cette récession a un effet immédiat sur le financement des groupes féministes. Par exemple, au fédéral, on dénote: des coupures dans le Programme de promotion de la femme ; l’abolition du Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme (1995)⁷.
Au milieu des années 1990, les regroupements féministes québécois font le constat du désengagement de l’État. Celui-ci se manifeste par une baisse de subventions allouées à ces groupes et par une diminution marquée de programmes destinés à la réalisation de projets féministes.
1993 : Au Québec, la récession économique marque une prédominance des enjeux de pauvreté dans les revendications féministes, notamment en raison de l’inquiétude quant à l’appauvrissement des femmes⁸.
1995 : Le féminisme québécois, rassembleur et ouvert à la diversité, met en place un mouvement national de coalition de femmes. La Marche du pain et des roses (20 mai au 4 juin 1995) réunie des milliers de féministes dans l’objectif de diminuer la pauvreté et d’améliorer la condition économique des femmes.
1996 : Des groupes de femmes au Québec constatent qu’ils vivent, depuis une dizaine d’années, les impacts graduels du désengagement constant de l’État. Passant des gels aux coupures, les subventions, liées aux programmes de soutien des groupes de défense des droits des femmes, sont grandement impactées. Les répercussions se font sentir sur les travailleuses qui ne sont pas en mesure d’effectuer leur travail dans des conditions adéquates. Le travail non rémunéré doit cesser. La nécessité de trouver de nouveaux moyens pour financer une partie des activités des groupes est donc rendue nécessaire. À cette recherche s’ajoute la pression continue sur l’État par les groupes de femmes afin qu’il procure un financement adapté et récurrent à ces derniers.
Le rêve devenu réalité
1996 : Divers organismes féministes provinciaux et régionaux sont approchés pour le projet d’habitation collective. Le 30 septembre 1996, à la suite d’une rencontre entre les groupes intéressés, les noms de Léa Roback et Madeleine Parent sont donnés au projet de la Maison pour souligner leur amitié et la diversité des mouvements féministes au Québec.
1997 : La Maison Parent-Roback est incorporée comme organisme à but non lucratif. Un toit pour toutes, une fois pour toutes prend forme. La Maison répond aux besoins de financement des groupes féministes en contrôlant les coûts de logement. De février à septembre 1997, différents immeubles sont visités dans les quartiers de Montréal.
1998 : En février, l’immeuble situé au 110 rue Sainte-Thérèse est acheté. Le rêve de créer un “symbole d’un projet de société féministe, plusieurs, ouvert et démocratique”⁹ devient réalité. L’inauguration de la Maison Parent-Roback se tient le 27 septembre 1998 dans ses nouveaux locaux.
2000 : La Marche du pain et des roses, qui s’est tenue au Québec cinq ans plus tôt, se reproduit à l’échelle mondiale. Or, elle porte un nouveau nom, soit la Marche mondiale des femmes de l’an 2000. Du 8 mars au 17 octobre 2000, se tient le « plus grand rassemblement féministe de tous les temps¹⁰». À la lutte pour contrer la pauvreté s’ajoute celle contre les violences sexistes¹¹. La préparation de la Marche se fait en grande partie dans les bureaux au cœur de la Maison Parent-Roback.
2004 : Le 10 décembre, pour souligner la fin de cette Marche, la Charte mondiale des femmes pour l’humanité est adoptée au Rwanda. Cette coalition internationale de femmes met en lumière la force des mouvements féministes à l’échelle internationale grâce à une initiative québécoise.
2017 : En novembre, la Maison Parent-Roback quitte le 110 rue Sainte-Thérèse pour s’installer dans un nouvel édifice situé dans le quartier Parc-extension. Après avoir étudié plusieurs projets de relocalisation depuis 2004, c’est le 469 rue Jean-Talon Ouest qui est choisi comme nouveau siège social de l’organisme.
2025 : La Maison Parent-Roback illustre la forte collaboration des groupes féministes québécois.
Aujourd’hui, ce projet d’immobilier collectif et féministe rend possible le partage d’espace et de ressources, la co-création et le plaisir, favorisant une meilleure concertation entre les membres.

Madeleine Parent et Léa Roback : deux sources d’inspiration
Le choix de nommer la Maison en l’honneur de Madeleine Parent et de Léa Roback fut une décision facile pour les groupes fondateurs.
Madeleine Parent et Léa Roback, étaient toutes deux des syndicalistes et féministes et de grandes actrices dans les mouvements des femmes du Québec. Au milieu des années 90, lors de la fondation de la Maison, elles étaient d’ailleurs encore très impliquées.
Comme le mentionne Charlotte Thibault, nommer la Maison en leurs noms était une manière de “souligner leur amitié tout comme la diversité culturelle de l’époque dans les mouvements des femmes”. Les groupes, tout comme les travailleuses, se voyaient les héritières de Madeleine et de Léa.
Léa Roback et Madeleine Parent sont des figures marquantes de l’histoire du Québec, auxquelles la cinéaste Sophie Bissonnette a consacré deux documentaires phares : Des lumières dans la grande noirceur ainsi que Madeleine Parent, tisserande de solidarités.
Découvrez le rigoureux dossier thématique de la Cinémathèque québécoise intitulé Pionnières du féminisme et du syndicalisme : Léa Roback et Madeleine Parent et réunissant une douzaine d’heures d’extraits vidéo organisés par thème et accompagnés de textes explicatifs rédigés par deux historiennes.

La cinéaste Sophie Bissonnette, Léa Roback et Madeleine Parent
Pour en savoir plus
Consultez les capsules historiques portant sur le projet de la Maison Parent-Roback : Cette production a été rendue possible grâce au financement de Femmes et égalité des genres Canada.

Équipe de réalisation : Juliette Balthazard / Alexia Toman / Louis-Félix Couture / Alexis Bouffard-Dumas / Mariam Ag Bazet / Josef Tulane / Sara Landry-Pellerin 👇
Références
¹ Descarries, Francine. 2005. « Le mouvement des femmes québecois : état des lieux ». Cités 23 (3). https://doi.org/10.3917/cite.023.0143. p. 150
² Thibault, Charlotte, et Maison Parent-RobacK. 2000. La petite histoire de la Maison Parent-Roback: un projet innovateur d’habitation collective. Montréal: La Maison. P.4
³ Toupin, Louise. 2005. « Voir les nouvelles figures du féminisme et entendre leurs voix ». Dans Dialogues sur la troisième vague féministe. sous la dir. de Maria Nengeh Mensah. Montréal : Les Éditions du remue-Ménage. p. 76
⁴ Relais-femmes (Association). 2006. « La course à Relais-femmes », Numéro spécial | 25 ans de Relais, 1 ressource en ligne. p. 20
⁵ Hilt, Caroline. 1998. « Après la reconnaissance, une nouvelle mise en marge? Le mouvement des femmes et la structure des opportunités politiques au Canada ». Groupe de recherche multidisciplinaire féministe, Cahier du GREMF, no Cahier 80, p. 67
⁶ Blais, Mélissa. 2018. « Masculinisme et violences contre les femmes : une analyse des effets du contremouvement antiféministe sur le mouvement féministe québécois ». Thèse, Montréal (Québec, Canada): Université du Québec à Montréal. https://archipel.uqam.ca/11768/. P.143
⁷ Québec (Province). Conseil du statut de la femme. 2007. La constante progression des femmes : historique des droits des femmes. [9e éd.]. The long march forward. [Québec : Conseil du statut de la femme]. http://collections.banq.qc.ca/ark:/52327/45311.
⁸ Trudel, Flavie. 2009. « L’engagement des femmes en politique au Québec : histoire de la Fédération des femmes du Québec de 1966 à nos jours ». Thèse ou essai doctoral accepté, Montréal (Québec, Canada): Université du Québec à Montréal. p. 76, 29711. Descarries, 2005, op. cit., p. 15
⁹ Martin, Céline. 1998b. « Discours ouverture Maison Parent-Roback ». Présenté à Inauguration de la Maison Parent-Roback, Maison Parent-Roback, septembre 27.
¹⁰ Descarries, Francine. 2007. « Chronologie de l’histoire des femmes au Québec et rappel d’événements marquants à travers le monde ».
¹¹ Marche mondiale des femmes (Association), Tatiana Berringer, Nancy Burrows, Graziela Schneider, Clarisse Alo, Camila Candido, Nathalia Capellini, et al., éd. 2008. La Marche mondiale des femmes: 1998-2008: une décennie de lutte internationale féministe. Sao Paulo, Brésil: Sempreviva Organizaçao Feminista.